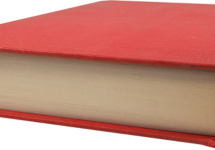« L’Allemagne n’a ni bon sens économique ni compassion », affirmait Joseph Stiglitz en pleine crise du Grexit en 2015. Un propos qui fait écho à l’idée que l’Allemagne pratiquerait une forme d’austérité « radicale » et contre-productive pour l’Europe. Mais qu’en est-il vraiment ? À la veille des élections législatives allemandes, la mise au point de Rémi Lallement, auteur d’une récente étude de France Stratégie sur le bilan et les perspectives socioéconomiques en Allemagne.

L’Allemagne est souvent dépeinte en gardienne du dogme de l’austérité. Pourquoi ce portrait vous semble-t-il caricatural ?
D’abord parce que la règle des 3% [ndlr : la limite maximum fixée par le traité de Maastricht pour les déficits des États en pourcentage de leur PIB] n’est pas aussi rigide et stupide qu’on veut nous le dire. L’Allemagne elle-même ne l’a pas toujours respectée et la France la transgresse chaque année depuis 2008 ! Le problème, c’est que, nous, Français, y voyons surtout l’aspect juridique, « couperet », la contrainte supranationale. Mais cette règle, a malgré tout un sens. Parce qu’une politique budgétaire intelligente est une politique qui permet de maitriser la dette publique. Une dette publique soutenable, c’est des marges de manœuvre pour relancer l’économie en cas de crise. Et c’est aussi de l’argent public investi utilement plutôt que consacré au remboursement de la dette.
Donc quand le ministre fédéral allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, affirme qu’il a lu Keynes, ce n’est pas qu’une facétie ! Même si la séquence est à mettre en partie au crédit du gouvernement Schröder, c’est bien parce que l’Allemagne a su réduire ses déficits à partir de 2003 et revenir à l’équilibre en 2007, qu’elle a pu ensuite soutenir la demande en relançant ses dépenses publiques, plus franchement que la France à son échelle, en 2009-2010. Bilan : l’Allemagne est sortie de la crise avant nous qui n’avions pas su restaurer les mêmes marges de manœuvre budgétaire.
L’Allemagne a donc effectivement une stratégie keynesienne, de type contra-cyclique : elle resserre les comptes quand la croissance est là pour se donner les moyens (budgétaires) de faire face aux crises quand elles surviennent. La France des trente dernières années, de son côté, a le plus souvent mené une politique budgétaire acyclique, c’est-à-dire sans lien avec les fluctuations économiques, voire procyclique, c’est-à-dire qui les amplifie au lieu de les compenser.
Par ailleurs, poser la question en ces termes-là aujourd'hui, c’est un peu se tromper d’époque. En 2011-2012, c’était un débat : on pouvait craindre que si tous les pays européens mettaient en place des plans de rigueur simultanément, il y ait un risque de dépression pour l’ensemble de la zone, et donc répondre à l’Allemagne que son exemple ne pouvait pas être suivi par tous. Aujourd'hui, c’est différent. Tous les pays sont rentrés dans les clous [ndlr : du pacte de stabilité, c'est-à-dire sous les 3 % de déficit public]. Tous sauf l’Espagne et la France. En sachant que l’Espagne partait, elle, de plus de 10 % de déficit en 2012 ! La France peut donc difficilement se poser en (contre) modèle.
Mais vous évoquez dans votre étude, des excédents record outre-Rhin, c’est donc qu’il y a visiblement « encore » de la marge ! L'Allemagne ne pourrait-elle pas l’utiliser pour doper davantage sa croissance et entraîner le reste de l'Europe avec elle ?
Si, dans une certaine mesure. Mais c’est d’abord à l’échelle de la zone euro qu’il faut poser la question des excédents courants [ndlr : solde monétaire résultant des échanges de biens et services, des flux et transferts de revenus, entre la zone euro et le reste du monde]. L’Europe est collectivement en situation de sous-régime. La zone euro dans son ensemble a des marges de manœuvre pour augmenter sa croissance et vit finalement en dessous de ses moyens. De ce point de vue-là, Joseph Stiglitz a raison quand il affirme que l’Europe tire la croissance mondiale vers le bas.
Au niveau des pays, l’Allemagne fait partie, avec le Danemark et les Pays-Bas, de ceux qui dégagent les plus gros excédents de la zone, en pourcentage de leur PIB. En valeur absolue, c’est le premier. Elle est donc le pays le plus concerné par cette situation de sous-régime. Une situation régulièrement critiquée tant par le FMI que par l’OCDE ou la Commission européenne, même si être excédentaire peut être légitime pour un pays qui, du fait de sa démographie, épargne en prévision du vieillissement de sa population. Mais encore une fois, les temps ont changé. Même dans une Allemagne qui se rapproche maintenant du plein emploi, une demande intérieure plus dynamique reste souhaitable. Elle induirait à court terme un surcroît d’inflation et d’importations qui contribueraient ipso facto à la résorption des déséquilibres entre les pays de la zone euro. Et permettrait surtout à long terme un rééquilibrage du partage des revenus et des moteurs de la croissance devenus nécessaires outre-Rhin. Si, aujourd'hui, les Allemands entendent qu’ils peuvent lâcher du lest, c’est essentiellement pour cette deuxième raison et non pour « faire plaisir » à leurs voisins européens ou au reste du monde. Et aussi parce qu’il est clair que le haut niveau de compétitivité des entreprises allemandes permet un tel réajustement.
Du reste, la demande intérieure a déjà regagné en dynamisme, outre-Rhin. Côté consommation des ménages, même si c’est plutôt du ressort des partenaires sociaux en Allemagne, il y a eu l’introduction d’un salaire minimum. Côté investissement public, des dépenses pour le logement, la formation professionnelle, la petite enfance et l’accueil des réfugiés. Il reste cela dit des marges, c’est vrai, des besoins en tout état de cause : un retard notable dans le numérique, des infrastructures de transport qui laissent à désirer et un gap dans l’éducation malgré les dépenses engagées suite au « choc PISA » [ndlr : traumatisme collectif vécu par l’Allemagne en 2000 suite à la publication par l’OCDE des résultats de la première enquête PISA qui classait le pays en 21ème position sur 31]. Côté investissements des entreprises pour finir, avec une croissance annuelle réelle de 3 – 4 % ces derniers temps, c’est un peu le même constat : ça repart mais « peut mieux faire ».
Justement, jusqu’où l'Allemagne peut-elle faire mieux et quels bénéfices pourrait en attendre collectivement l’Europe ?
Elle pourrait faire mieux en allant un cran plus loin dans le rééquilibrage consommation/compétitivité. En Allemagne, ce sont les ménages qui ont financé en grande partie tant le rétablissement des comptes publics que la transition énergétique. Les entreprises, elles, en ont été largement exemptées, au nom de la compétitivité. Aujourd'hui elles sont très excédentaires et il serait sans doute opportun de réduire prioritairement les charges fiscales qui pèsent sur les ménages, pour consolider la relance de la consommation. Les citoyens allemands se sont longtemps serré la ceinture pour que leur économie soit performante – elle l’est redevenue – mais la finalité de cette performance c’est quand même qu’ils puissent vivre mieux, sinon ça n’a pas de sens, à moins d’en rester à un point de vue étroitement néo-mercantiliste !
En termes de bénéfices collatéraux pour l’Europe, il y a donc déjà ceux liés à l’augmentation de la consommation des ménages et des investissements des entreprises outre-Rhin, qui bénéficie aux partenaires commerciaux de l’Allemagne, dont la France. Il y a sinon une autre piste d’évolution déjà engagée mais qui reste à amplifier, du côté cette fois des investissements publics : c’est l’augmentation du budget de la Défense. Berlin a en effet pris acte de la nouvelle donne des relations transatlantiques et s’est récemment engagé à augmenter son budget, tout juste supérieur à 1 %, pour tendre vers les 2% souhaités par l’OTAN. Depuis quelques mois, le budget allemand de la Défense augmente plus vite que celui de la France. Signe des temps ?
Céline Mareuge, journaliste web