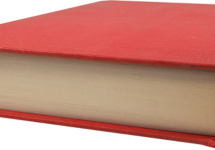La première épreuve est survenue au printemps 2010, lorsque l’UE a dû décider si, en dépit de la doctrine du no bail-out, elle voulait aider un Etat qui avait perdu son accès aux marchés. La deuxième a eu lieu en 2012, lorsque le fardeau de la dette est devenu trop lourd pour Athènes et qu’il a fallu demander aux créanciers privés de procéder à son allègement.
L'élection générale du 25 janvier pourrait bien déboucher sur troisième épreuve. Les sondages laissent attendre une victoire de Syriza. En ce cas, son chef Alexis Tsipras sera chargé de former un gouvernement. Syriza affiche ses priorités : une réduction de la dette publique, puis la conversion du stock restant en titres indexés sur le PIB; l'abrogation de plusieurs réformes du marché du travail inspirées par la Troïka, dont la baisse du salaire minimum de 22 % instaurée en 2012 ; et enfin une réforme politique.
Pour l'UE, cette perspective soulève d'abord une question financière. Lorsque la Grèce renégocia sa dette publique en 2012, ce fut avec ses créanciers privés ; les prêteurs officiels – le FMI et les Etats membres de la zone euro – ne furent pas affectés. La restructuration donna lieu à un allégement de plus de 60 % de la dette et à des pertes pour les créanciers à hauteur de 100 milliards d’euros. Cette fois, cependant, toute renégociation de la dette affecterait les créanciers officiels, pour la simple raison qu'il n'y a presque plus de créanciers privés.
Dans son dernier examen du programme grec, le FMI a averti que « l'engagement politique à l’égard de la stratégie de gestion la dette sera mis à rude épreuve à l'avenir » et a souligné qu'il était essentiel pour les partenaires européens de se tenir « prêts à fournir un soutien supplémentaire si nécessaire pour maintenir le ratio de dette sur le sentier fixé ». Visiblement, il considère que les Grecs ont quelques raisons d’être lassés de l’ajustement budgétaire. Mais bien qu’il ait prêté au même titre et dans le même cadre que l'UE, le Fonds n'a pas l'intention de participer à un quelconque allègement et se contente de suggérer aux États européens de réduire le fardeau qui pèse sur Athènes. La chancelière Merkel, le président Hollande et leurs collègues, qui sont aussi créanciers, sont naturellement moins enclins à présenter l’addition à leurs contribuables nationaux.
L'autre question est politique. Si le programme de Syriza est en partie compatible avec les exigences de la Troïka – notamment lorsqu’il prône la suppression des privilèges fiscaux et des rentes dont bénéficient les oligarques grecs – il s’y oppose frontalement à d’autres égards. La hausse du salaire minimum, l'abrogation des réformes du marché du travail et l'embauche de fonctionnaires, pour ne citer que ces trois mesures, remettraient profondément en cause le programme négocié avec la Troïka.
La question est importante, car il s’agit au fond des marges d’autonomie pour des choix politiques nationaux au sein de l'union monétaire. Jusqu’à présent, les gouvernements européens de gauche comme de droite se sont essentiellement conformés aux exigences de l'UE. Que se passera-t-il si un gouvernement Syriza sort du rang ?
Pour définir sa ligne de conduite, l’Union serait bien inspirée de prendre pour critère la nature des désaccords à venir : un nouveau gouvernement mettra-t-il en question les exigences de rang constitutionnel consacrées dans les traités, ou adoptera-t-il seulement une politique différente tout en restant dans le cadre constitutionnel commun ? Le rôle des dirigeants de l’Union n’est pas d’exprimer une préférence quant au résultat d’élections démocratiques, il est en revanche de rappeler à tout gouvernement les engagements de premier rang auxquels tous les participants à l’euro ont souscrit.
Si Syriza l’emporte, il y aura naturellement des discussions entre le nouveau gouvernement et l’UE. Si, comme on peut l’attendre, la confrontation touche à la frontière entre domaine constitutionnel et domaine politique, son résultat sera décisif pour l’avenir de l’euro. En effet si les obligations constitutionnelles sont définies de manière trop étroite, l'UE sera accusée de nier au peuple grec le droit à des choix démocratiques. S’en suivra en Europe une réaction politique qui affaiblira le soutien à l'union monétaire. A l’inverse, un cadre trop souple signalerait que les engagements en matière de réformes et de discipline fiscale sont de peu de valeur. Cela effrayerait les marchés financiers et renforcerait l’acrimonie des faucons budgétaires, en Allemagne et ailleurs.
L’équilibre trouvé sera donc d'une importance majeure. L’avenir de l'euro et de ses règles va probablement se jouer dans les prochaines semaines. Après 2010 et 2012, la troisième épreuve grecque pourrait bien être la plus ardue.