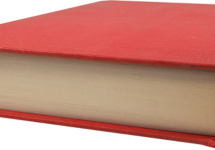J’y remarquais que de nombreux électeurs, au Royaume-Uni et ailleurs, étaient en colère contre ces mêmes experts, qui avaient à leurs yeux échoué à prévoir la crise financière de 2008, n’avaient à la bouche que l’efficacité et ne cherchaient guère à savoir comment les perdants des politiques économiques qu’ils préconisaient pourraient être dédommagés. Je plaidais pour l’humilité et une plus grande attention aux questions de redistribution.
Cet article a suscité beaucoup plus de commentaires de lecteurs qu’aucun de mes précédents papiers. Leurs réactions confirment pour l’essentiel la colère que j’avais signalée. Les économistes et autres experts y sont dépeints comme coupés des réalités, indifférents aux préoccupations des gens ordinaires et animés par des motivations étrangères à celles des citoyens. On leur reproche de se tromper souvent et par conséquent d’être incompétents ; d’être influencés par les grandes entreprises et l’industrie financière, quand ils n’en sont pas purement et simplement les otages ; et par-dessus le marché d’être naïfs – incapables de voir que les politiques ne retiennent de leurs analyses que celles qui servaient leurs propres vues. Les experts, disent certains, sont aussi coupables de diviser la société, parce qu’ils cloisonnent le débat et le décomposent en myriades de discussions spécifiques et étriquées.
J’ai également reçu des témoignages de spécialistes des sciences dites « dures » qui disent ressentir dans leur discipline cette défiance croissante envers les experts. Dans des domaines comme l’énergie, le climat, la génétique et la médecine, les scientifiques sont de plus en plus souvent confrontés au rejet de leurs analyses. Ainsi, aux États-Unis, une enquête du Pew Research Center établit que 67% des adultes jugent que les scientifiques ne comprennent pas clairement les effets sur la santé des organismes génétiquement modifiés. En Europe, les OGM suscitent encore plus de doutes. Si les sciences bénéficient toujours d’un large soutien, nombreux sont ceux qui considèrent qu’elles sont manipulées par des intérêts privés ; et sur certains problèmes, l’opinion commune s’écarte des résultats que la recherche et la pratique scientifiques ont pourtant établis.
Cette division entre les experts, d’une part, et les citoyens, d’autre part, est un vrai motif d’inquiétude. La démocratie représentative se fonde non seulement sur le suffrage universel mais aussi sur la raison. Idéalement, les délibérations et les votes doivent se traduire par des décisions rationnelles qui s’appuient sur l’état des connaissances pour permettre aux décisions politiques d’améliorer le bien-être des citoyens. Un tel fonctionnement requiert des experts à la compétence et à l’honnêteté reconnues capables d’informer les décideurs sur les options dont ils disposent pour répondre aux préférences exprimées par les électeurs. Mais les citoyens ne pourront pas être satisfaits s’ils pensent que les experts font valoir leurs propres priorités ou sont les otages d’intérêts privés. La défiance envers les experts nourrit la méfiance envers les gouvernements élus, sinon envers la démocratie elle-même.
Pourquoi assiste-t-on à une telle fracture entre les experts et le reste de la société ? En partie parce que tous les pays ont connu des scandales retentissants touchant à la santé ou à la sécurité publiques. Des experts se sont rendus coupables de négligences ou bien se sont laissés prendre au piège de conflits d’intérêts. Des réputations durement gagnées se sont effondrées.
Mais les critiques ne reconnaissent généralement pas que la science est plus exigeante et plus rigoureuse que, par exemple, les affaires ou l’action publiques. La science est en vérité le parangon des bonnes pratiques pour ce qui touche à la validation des analyses ainsi qu’à la discussion de leurs implications pour les politiques publiques. Des erreurs surviennent régulièrement dans le monde académique, mais elles y sont plus rapidement et plus systématiquement corrigées qu’ailleurs. La nature collective de la validation scientifique fournit aussi des garanties contre la mainmise des intérêts privés.
Le problème pourrait être, en fait, plus profond que les doléances habituelles contre les experts ne le laissent entendre. Voici seulement quelques décennies, on considérait généralement que la massification de l’enseignement comblerait peu à peu le fossé entre le savoir scientifique et les croyances populaires, par conséquent qu’elle contribuerait à une démocratie plus sereine et plus rationnelle.
À l’évidence, il n’en est rien. Comme l’a éloquemment montré le sociologue français Gerald Bronner dans La démocratie des crédules, les progrès de l’éducation n’accroissent pas plus la confiance dans la science qu’ils ne diminuent l’attraction de croyances ou de théories que les scientifiques considèrent comme de pures absurdités. Au contraire, des citoyens mieux éduqués supportent moins bien que les experts aient le monopole de la vérité scientifique. Ayant eu accès au savoir, ils se sentent plus autorisés à critiquer les sachants et à développer leur propre point de vue.
Le changement climatique – considéré par une écrasante majorité de la communauté scientifique comme une menace majeure – a ici valeur d’exemple. Selon une enquête menée en 2015 par le Pew Research Center, les trois pays où il suscite le moins d’inquiétudes sont les États-Unis, l’Australie et le Canada, alors que les trois pays où l’opinion en est la plus préoccupée sont le Brésil, le Pérou et le Burkina Faso. Dans le premier groupe, la durée moyenne de fréquentation d’un établissement scolaire est de douze années et demie, tandis que dans le second elle n’est que de six années. À l’évidence, ce n’est pas l’éducation qui explique cette différence de perception.
Si le problème doit perdurer, nous ferions mieux d’en faire plus pour tenter de le résoudre. Il nous faut d’abord une communauté d’experts plus exigeante. La rigueur intellectuelle qui caractérise la recherche fait souvent défaut dans les débats sur les politiques publiques. L’humilité, des procédures rigoureuses, la prévention des conflits d’intérêt, la capacité à reconnaître ses erreurs et, aussi, la répression des comportements frauduleux sont nécessaires pour regagner la confiance publique.
En second lieu, il convient de réexaminer les programmes scolaires afin qu’ils fournissent mieux aux futurs citoyens les outils intellectuels dont ils auront besoin pour distinguer le vrai du faux. La société a tout à gagner à ce que les citoyens soient moins suspicieux et plus critiques.
Il nous faut enfin améliorer les instances de dialogue et de débat informé. Les revues d’intérêt général, les magazines et les journaux remplissaient traditionnellement un espace situé entre l’éther des revues à comité scientifique et la vaste mer des impostures. Cette presse doit aujourd’hui se battre pour survivre à la révolution numérique. D’autres instances, de nouvelles institutions peut-être, sont nécessaires pour remplir cet espace. Il est certain, quoi qu’il advienne, que la démocratie ne pourra prospérer s’il demeure vide.